Proposés par François Bon sur le Tiers Livre Éditeur
Thème : le lieu
Atelier I : un seul paragraphe, point virgule comme unique ponctuation, un lieu qui suppose cette explication écrite, surgira par elle
Atelier II : phrases nominales rendant compte d’un déplacement à l’extérieur en cinq temps, comme des diapositives en mouvement, trajet d’enfance
Atelier III : sur le modèle de la rue Vilin de Georges Perec, un lieu qui recèle un secret où l’on retourne, une description en diptyque (autrefois et aujourd’hui) aussi neutre et précise que possible, proche du réel, l’épuisant
Atelier IV : un lieu intermédiaire (coulisses, vestiaires, salle d’attente) qui sert de transition entre un espace et un autre, un état et un autre, pour un rituel laïc ; le décrire sans je
Atelier V : un escalier, sans son point de départ ni d’arrivée, pouvant donner sur d’autres escaliers, ses marches éveillant le souvenir d’autres marches, le monter ou le descendre dans un style qui rende compte de la continuité, chaque contribution formera une marche du texte escalier collectif, possibilité de contribuer plusieurs fois en écho aux marches des autres
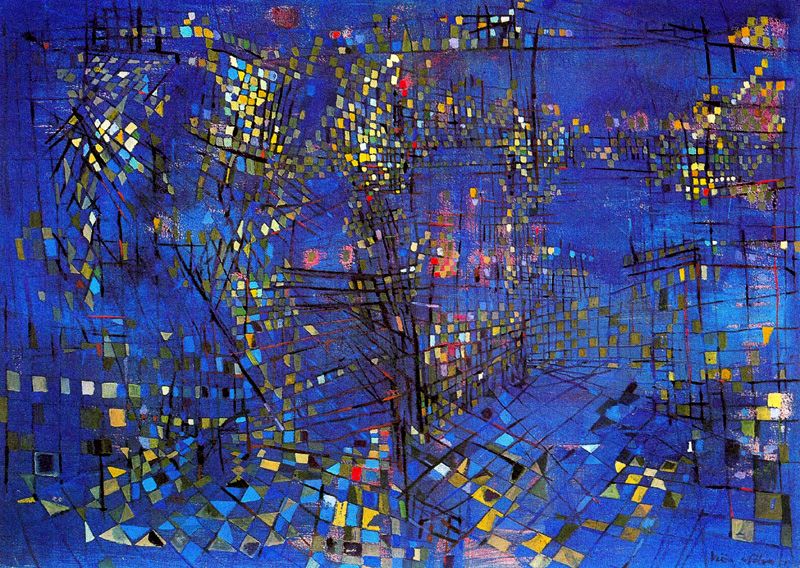
I
La falaise fait de l’ombre au soleil ; tachetée du blanc des embruns ; des plumes ; des fientes ; marbrée de vert mouillé ; d’un reste de paradis ; au loin le toit fumant ; le cœur glisse des mains ; se renverse ; roule ; rebondit ; il flotte ; vaudrait mieux sombrer ; nausée ; englouti le bateau ressurgit ; une inlassable traversée de haut en bas en haut ; vers rien ; la mer même déchaînée est monotone ; c’est sa manière de torturer ; des ailes traversent la brume comme se disperse une lettre déchirée ; la queue d’un cachalot fracasse les vagues ; pulvérise les lieux passés et à venir ; qui s’éparpillent scintillants sur les planches ; le sel souligne en les brûlant les lèvres qui sourient ; les paupières qui se ferment ; le sang figé s’anime ; la vie se réjouit d’être secrète ; la peur c’est le seul moyen d’être ici ; loin de l’ailleurs encombré par les autres ; morts et vivants indifféremment ; la falaise couvre le ciel ; le bateau échoue dans les ténèbres ; le cœur s’est perdu ; il ne compte plus ; faudra marcher ; rejoindre la maison ; déjà ici s’oublie ; qui sait le regarder ; quitter les limbes de la pensée ; on naît ébloui de présent ; l’île dentelée s’avance ; elle n’aime pas la chair ; que les os ; blancs comme sa neige éternelle ; c’est insensé ; peut-être c’est ça la beauté.
II
Les volets clos encadrés d’or sous les tuiles sillonnées d’herbe folle et de fleurs sauvages. Interdiction d’entrer avant d’être appelée, ordre dès le matin d’aller jouer au jardin. Les flaques miroitantes sous les réverbères que les semelles brisent et les pieds s’enfoncent dans un fleuve de nuit, d’où surgit une main glacée qui s’agrippe aux chevilles, aux cuisses, à l’… Les pavés, mosaïque de roses et de caravelles où les souliers reluisent. Le collant en laine trempé et le silence des villes – menacé, ou menaçant. Elle aux tresses en couronne, tournoyant, robe étoilée, par fierté.
Le porche avec sa lourde odeur de pois chiches et de jasmin, la loge aux vitres en dentelle et à la poignée de laiton, maison pour une poupée de chiffon qui s’appelle Hélène, la cour où tombent les plaintes et les pelures, la cendre et l’attente, l’escalier qu’il vaut mieux dévaler le matin, avec en bandoulière l’arc vaste des rêves et le carquois rempli des flèches fines et précises qui les réaliseront, que monter le soir, à petits pas polis, par respect des voisins et envie de s’envoler en douce, au-dessus des toits mouillés, dans le ciel violacé dont bientôt il ne restera rien.
Le palier où les fenêtres projettent des croix étroites et étirées ; et dans ce cimetière révélé par la lune, s’arrêter. Savoir, assise sur une marche, qu’on ne guérira jamais de l’enfance, que la mère en garde une épine dans le dos, le père un sifflement aux oreilles, et soi déjà un nœud à la gorge – l’inconsolable tout contre la voix, pas de sirop contre ces larmes-là.
La lumière sur le paillasson blond, le parquet, les fenêtres, le plafond. Le cimetière enseveli et elle soudain reflétée : soulevé le voile de nuit, un visage d’or et d’ombre. S’échappant par la porte ouverte, l’oiseau noir en bataille « on t’avait oubliée », qui frôle ses cheveux et entaille son front de ses ailes aiguisées. Le sang chaud coulant sur son visage qu’elle regarde sans ciller. Comme une envie de mourir dans les poings fermés.
III
C’est une tombe. Une dalle parmi les dalles. Sauf que celle-ci porte ton nom. Des chiffres pour se repérer, éparpillés alentour, sur des pancartes, des cadrans, des plaques : allée 6, rangée 12, 9°, 11h23, 1849-1870, 1860-1901, 1911-1912, 1888-1915, 1890-1915, 1910-1942,… Une pierre d’un mètre sur deux, une croix presque aussi grande que toi. Du gravier rose et bleu (ne te mouche pas comme ça, on n’utilise qu’une main, ne sois pas vulgaire), les bottines vernies et pointues, le collant qui gratte, son odeur de lessive, laque et crème, le moineau qui sautille, picore, sautille, picore, sautille (ah là là, comme j’aurai froid là-dessous. Je le sens déjà, tu sais ? Dans les os… Tu me mettras mon châle, le mauve.) Ses mains fragiles sortent du manteau de fourrure et fouillent dans le sac en cuir (ah c’est moche de vieillir, je te le dis. Ne froisse pas ton front, ça te fera des rides). Elle prend deux bonbons et t’en offre un. Une femme passe en parlant étranger à un homme qui te regarde. Le caramel réchauffe et adoucit. La pierre, son grain, son gris, son usure aux coins, sa netteté de porte, pilier, pont. Elle y dépose les chrysanthèmes avec cette grimace de quand elle se penche. Tu fermes les yeux et elle fredonne (quand nous chanterons le temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur…)
C’est une tombe. Une dalle parmi les dalles. Sauf que celle-ci porte ton nom. Un ange déploie ses ailes immenses et scintillantes à travers l’allée. Son corps mince et pâle s’efface presque au visage. Il s’élance les bras levés et les pieds joints, comme pour plonger dans le ciel, mais ses ailes le retiennent, prises aux branches noires et nues d’hiver qui portent des étoiles. Les chiffres : allée 6, rangée 12, 3°, 17h15,… 1935-2013. Les mêmes initiales que toi, tu n’y avais jamais pensé. Tu lui as mis son châle, comme promis. Le ciel a un bleu de velours. La ville clignote de guirlandes et de phares. Elle se vide, Noël approche et tu n’as pas de fleurs. Tu éclaires avec ton portable : Claude, Jeanne, Justine, Xavier, Henriette, André,… Elle. Le gravier n’a rien de rose et bleu. Un écureuil se faufile entre deux pots, s’arrête sous la croix, puis repart. Dans le noir il ne reste que les chuchotements des derniers visiteurs, le crissement de leurs pas qui s’éloignent. Le cimetière n’en est plus un. Ses masses se transforment et s’animent, comme les vêtements en tas sur la chaise qui se changeaient la nuit en sorcière crochue. Tu sursautes à une explosion lointaine qui te semble intérieure. Il te vient de fredonner : quand nous chanterons le temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur…
IV
L’horloge tapote discrètement ses minutes sur le mur – patiente et polie, noire et blanche, à l’exception du rouge vif de l’aiguille saccadée des secondes et de la marque en majuscules : MONDAINE. Ses sœurs se trouvent dans les gares et les aéroports, elle dans un hall d’hôpital, toutes mariées à l’attente et au départ.
Des baies vitrées de chaque côté donnent sur un jardin dans la ville qui reflète la ville, quadrillé d’allées, de buis et de pensées, labyrinthe qui se délabre et se reconstruit inlassablement dans ses failles. Y avance une mère soucieuse, incertaine que sa fille tente de faire sourire.
Elles viennent pour la première fois et choisissent la place qu’elles occuperont semaine après semaine pendant des années, à l’écart, face à l’horloge, protégées par le piano droit. Entre les rangées de chaises, dans des caisses et sur les tables basses, s’entassent et dégringolent peluches, poupées, légos, kaplas, albums, bandes dessinées, magazines et roule jusqu’à leurs pieds un ballon mappemonde.
La petite fille ne touche à rien, ni ne se mêle aux enfants. Elle regarde dans le vide, ce qui rend la mère plus soucieuse, incertaine. Pour la soulager, d’autres viendront la remplacer, le grand-père distrait, le père charmeur, le frère d’un an plus âgé – et ce sera, pour une journée, l’aventure d’être des enfants abandonnées, Hansel et Gretel, Petit Poucet et Poucelina, Boucle d’or et son ours.
L’horloge aime cette petite parce qu’elle sait attendre. C’est une rêveuse. Elle n’a besoin de rien. Plus tard elle viendra seule et amènera des livres, des cahiers, des polycopiés, plus tard encore un portable, une tablette, un téléphone, mais ne les touchera pas davantage. Elle regardera dans le vide et vivra une vie en une minute, une seconde en trois heures. Son immobilité attire l’attention, une infirmière la prend pour une poupée et sursaute en la voyant se tourner vers sa mère et parler.
Adulte, elle ne se souviendra pas de ce lieu, vu et revu jusqu’à l’aveuglement. Aucun objet, aucun visage. Seuls quelques signes japonais enseignés par une autre enfant malade, le goût étrange de l’eau au robinet, l’odeur de javel du carrelage où la serpillère s’écrase comme se répand le poulpe. Elle pousse très loin l’art de l’absence.
La terreur l’empêche de s’incarner dans cet endroit, la peur panique des chambres sombres ou surilluminées où on la déshabille, l’endort, l’ouvre, qu’elle exprime à sa manière d’enfant sage : par un silence de neige qui fond en effleurant la mer. L’horloge la regarde s’amenuiser puis disparaître au bout du couloir, dans la pièce où luisent les écrans et le matériel en acier, et sait qu’elle entre d’un même pas dans son royaume intérieur, inaccessible.
Rêve-t-elle de l’attente en attendant ? De sa première attente, réfugiée dans le ventre de sa mère assise dans une salle semblable ? De sa dernière attente, isolée et exposée sur lit à roulettes glacé dans un sous-sol anonyme, depuis longtemps désertée par sa mère et par son âme même ? Rêvait-elle déjà et rêvera-t-elle encore dans ces attentes extrêmes ?
Longtemps l’horloge ne la voit plus. Elle a passé l’âge pour cet hôpital. Un jour pourtant, elle s’avance dans l’allée du jardin citadin, tenant une enfant par la main, ouvre la porte où s’affiche un spectacle de Guignol, vient s’asseoir à la place d’autrefois ; et comme autrefois la fille sert de pansement à la mère déchirée. Celle-ci porte au poignet une montre MONDAINE au mince bracelet rouge, fille d’une horloge mariée à l’attente et au départ. Pour la première fois, elle lève les yeux vers celle accrochée au mur, entre les baies vitrées et la fixe d’un regard dur, sans rêve. Les aiguilles s’arrêtent, le verre se fêle.
V
Un escalier est une échelle de Jacob, le territoire d’un ange. Chacun enseigne à sa manière la chute et l’envol, articulant le corps en le désarticulant, le privant de son poids régulièrement réparti en pas, à l’étage, au palier, au rez-de-chaussée, pour l’élever à un équilibre à la fois précaire et parfait. Tant de façons que ça se déglingue et dégringole et pourtant, la plupart du temps, ça tient, ça marche – si on n’y pense pas. Vacance de la conscience, marche puissance marches, pensée que se déploie et bat, de la racine du crâne irradiant le dos jusqu’aux doigts, déclenchée, relancée par les genoux, les chevilles, refoulée se logeant sous le pied, solidifiée dans les cals. Il faudrait inventer la promenade des escaliers : un escalier donnerait sur un autre escalier, à l’infini. Mieux qu’une errance dans les bois frémissants ou qu’une traversée des villes hallucinées. On entrerait vraiment dans le labyrinthe intérieur, finissant par connaître toutes les clefs, les portes et les couloirs. L’esprit d’escalier, qui survient toujours dans un escalier qui descend, se poursuivrait dans un escalier qui monte. On rejouerait ainsi l’après-coup et le contre coup ; et on raterait encore, pour rejouer encore. Plus de pensée plane, plate, paisible, ce serait torturé, compliqué, mystérieux, tarabiscoté, vertigineux. On vivrait dans les immeubles comme dans nos entrailles, escargots nous fermant sur nous-mêmes en un escalier en colimaçon qui serait notre maison. Sauf que… N’oublions pas les fenêtres, la magie des escaliers, ce qui les rend à la fois souterrains et aériens, entre l’enfoncée vers le centre de la terre et la grimpée du haricot magique. Au centre des rêves, un escalier va de la terre au ciel, sculpté dans l’arbre de vie. Je préfère les meurtrières. L’étroitesse est intensité – escaliers des tours fendus d’une épée de clarté. Petite leçon de galanterie : dans l’escalier l’homme précède toujours la femme, le seul cas. Quand il descend pour la retenir si elle trébuche ou ouvrir la porte sur le dehors et son danger ; quand il monte pour ne pas regarder ses jambes, l’attache de ses bas ou plus encore. Petite leçon d’incorrection : ne pas oublier de dévaler les escaliers, grande jouissance entre le piétinement et l’envolée. La basse matérialité devient ivresse métaphysique. Ne pas laisser ce geste sacré à l’enfance, ou au sérieux d’un retard. Se défaire de tout embarras. Il suffit de voir l’élégance de Proust, gris perle, rayant l’écran et l’église de la Madeleine parmi tant d’engoncés et d’empesés, ou la grâce de ces femmes précipitées sur leurs talons aiguilles (comment font-elles ?) que l’escalier transforme en hérons ou flamants. Pour la montée restent les enjambées, deux à deux, quatre à quatre, faire ses gammes, apprendre à jouer de son corps, avec une fierté insensée. L’escalier résonne. Fiole de souvenirs, il conserve les échos, tant d’éclats de voix et de chutes de bruits échappés des rainures, fissures et entrebâillements. Il est tout ce qui reste sur mon étagère de la maison natale, qui n’est plus qu’une maison sonore. Un escalier en ébène, sobre et massif, sans rambarde ni ornement, aussi raide et glissant qu’un toboggan, donnant droit dans la porte ouverte sur l’herbe humide ensoleillée, puis peu à peu, en descendant, sur les arbres penchés, grinçants, le ciel sifflant, à peine ennuagé. Les parents s’inquiétaient : les enfants tomberaient. Mais ce fut la grand-mère qui trébucha et se cassa deux côtes. Les petits le sentirent dans leur chair et haïrent l’escalier, pendant quelques jours, le temps de lui pardonner : il était bon et doux, brutal sans le vouloir, inconscient de sa force, ours se retournant dans son sommeil de bois.
*
Elle aimait les bords du monde, paliers et parapets, échelles et passerelles, s’avançant sur les arrêtes des toits, se dessinant des ailes dans le dos avec ses os. Mais elle vivait à l’ombre d’un escalier, je dirais même dans ses replis, à attendre le client puis monter avec lui – montée qui descendait. Il lui fallait du fric pour se casser, pas ici ou là précisément, juste loin, laisser glisser à ses pieds et se froisser cette vie comme l’une de ses robes. Elle haïssait les lieux qui lient – les milieux, ne désirant que début et fin, la minceur de l’extrême. L’escalier, c’était le pire, cette répétition laborieuse et médiocre du même, être tout un chacun entouré de voisins, manger, dormir, aimer, se fondre dans l’universel des sensations et des souvenirs qu’elle voulait déchirer, avec son orgueil d’ange. Envoûtante de violence. Elle glissa un papier plié sous la planche d’une marche soulevée aux ongles : « Ci-gît l’espoir »… « J’ai l’errance au cœur », disait-elle quand venait la langueur. Un jour, elle s’est passée de l’escalier – elle a pris la fenêtre. Sa mère s’affairait dans la cuisine. Surprise par la rumeur soudaine au dehors, elle est entrée dans la chambre pour l’interroger et a trouvé le vide.
Laisser un commentaire